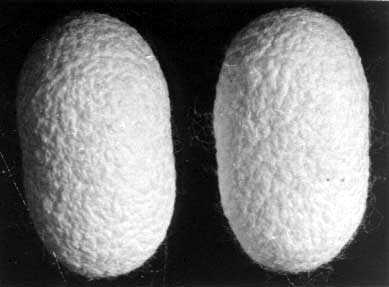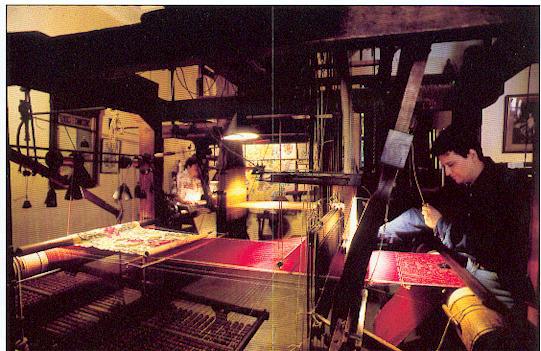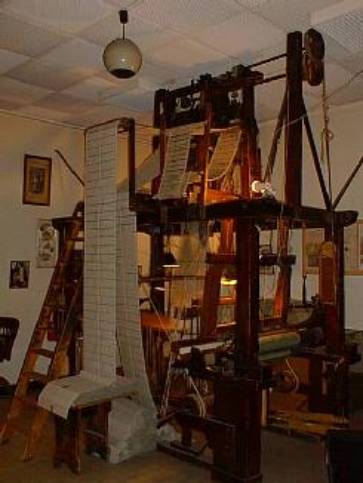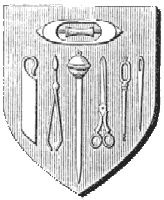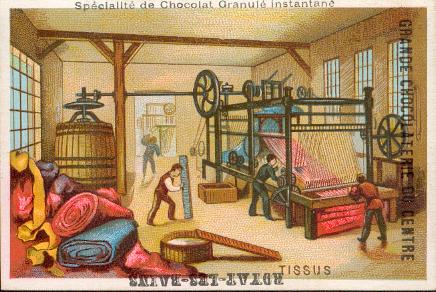OUVRIER EN SOYE (André ROUSSEL)
MAITRE OUVRIER EN SOYE (Jean-François
ROUSSEL)
Marchand Maître OUVRIER EN SOYE (Jean-françois ROUSSEL père et François
ROUSSEL)
à
TOURS

OUVRIER EN
SOYE Jacquardier ou
jacquardié : ouvrier qui
travaille sur un métier monté à la Jacquard, puis désigne progressivement tous
les ouvriers en soie.
Cette « manufacture »,
spécifiquement urbaine, est, comme presque toutes les manufactures textiles,
dispersée. Elle se présente sous la forme de petits ateliers domestiques, situés
dans des maisons particulières et éparpillés dans quelques paroisses3.
Physiquement, la manufacture est donc peu visible, mais le fait qu’elle soit
présente partout, permet à ses membres de se rencontrer dans toute la ville :
« Au lieu de quelques manufactures de soie, contenant chacune quelques centaines
de métiers groupés dans un espace restreint, c’était comme une cité dans la
ville et comme un monde de métiers, dont le bruissement animait du matin au soir
les quartiers urbains et suburbains » L’organisation économique de cette
manufacture est très hiérarchisée. Au bas de l’échelle se trouvent la plupart
des métiers spécifiquement féminins, qui peuvent aussi être à la campagne : les
rouetteuses, les encaneuses, les moulinières, les dévideuses, les ourdisseuses.
Ensuite viennent ceux qui travaillent au tissage sur les métiers : les plus
nombreux sont les ouvriers[ères]
en soie, mais
les maîtres-ouvriersy
oeuvrent également, pour leur compte ou pour autrui. Dominique Godineau, en
se fondant sur différents travaux de recherche, rappelle que, même si ces
derniers possèdent une maîtrise et dirigent un atelier, ils sont sous la
dépendance économique des marchands-fabricants ; leur statut est proche de celui
des salariés… Enfin, au sommet de cette hiérarchie se trouvent les marchands-maîtres-ouvriers,
les marchands-fabricants et les négociants qui contrôlent la production et la
commercialisation de la soie.
La fabrication de la soie


|
La soie
 |
|
|
La soie provient du papillon Bombyx
mori de
son vrai nom. Sa chenille, appelée ver à soie, produit un fil employé
pour la fabrication de la soie. On le trouvait à l'origine dans les pays
où poussait le mûrier blanc, c'est-à-dire en Chine, en Inde, en Perse.
Il est rapidement devenu complètement domestique au point que la
chenille a besoin de l'homme pour se nourrir et que le papillon ne sait
pas voler. |
 |
|
|
La femelle du
Bombyx pond de 300 à 500 oeufs (appelés "graines"), puis meurt peu
après. Pour qu'ils éclosent, il est nécessaire de les maintenir au
chaud. On utilise des couveuses aux parois remplies d'eau chaude,
appelées "castellets". |
|
|
Le ver à soie
 |
|
|
À sa
naissance, le ver mesure quatre millimètres. Il passera les cinq
semaines de sa vie à engloutir des feuilles de mûrier, pour atteindre 10
centimètres. Son poids sera multiplié par 10 000 et il subira quatre
mues. A la fin de sa vie, il faut l'alimenter en feuilles quatre fois
par jour. |
|
 
|
|
Le cocon

|
|
Les chenilles
grimpent sur des supports et s'y attachent à l'aide d'un fil.
Il leur faut deux jours pour s'installer et commencer à filer le cocon.
Il leur faudra régurgiter un à deux kilomètres de fil pendant quatre
jours pour former ce cocon. |
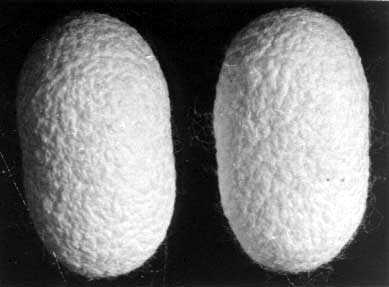 |
|
|
La fabrication de
la soie

|
|
|
 |
On empêche les
chrysalides de se transformer en papillon, car en sortant du cocon, le
papillon le percerait et briserait le fil. Les chrysalides sont donc
étouffées à l'aide d'air chaud. Autrefois on les plongeait dans l'eau
chaude pour dévider le fil de soie.
La dévideuse réunit
plusieurs fils de cocons ,de quatre à dix selon la grosseur du fil
désirée, et les dévide en même temps. Le fil ainsi constitué est
recueilli sur le dévidoir.
|
|
|

 |
Le moulinage
consiste à tordre ensemble plusieurs fils de soie pour plus de solidité.
Plus le fil est tordu, plus l'étoffe sera souple.
On fait bouillir les écheveaux avec un dissolvant afin d'éliminer les
dernières traces de grès. Le grès, aussi appelé séricine, est une
matière qui entoure le fil de soie. La couleur du grès dépend de la race
du vers, alors que le fil de soie est toujours blanc. Le fil est ensuite
imprégné d'alun afin de pouvoir recevoir la teinture. L’alun est un
produit qui sert à fixer la teinture.
|
|
|
Le tissage

|
|
|
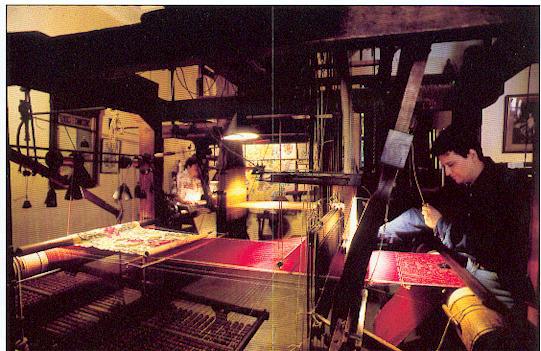 |
Dernière étape de la production de
la soie, le tissage s'effectuait sur des métiers à bras jusqu'au début
du XIXème
siècle. |
|
|
Métier à bras |
|
|
|
La mécanisation
et l'arrivée du métier Jacquard augmentèrent alors considérablement les
capacités de production. C'est à cette époque que Lyon devint la
capitale mondiale de la soie. |
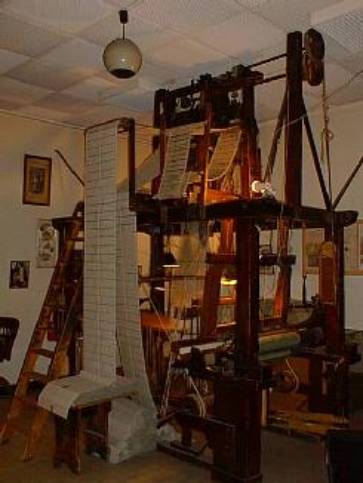 |
|
|
Métier Jacquard à
cartons perforés |
|
Manufactures de Soie à Tours.
Ce fut en
1470 que Louis XI, Roi de France, établit à
Tours des Manufactures de Soie. Les premiers ouvriers qui
y travaillèrent, y furent appelés de Gènes,
de Venise, de Florence, & même de la Grèce;
& en 1480 au mois d'octobre, ce Prince leur
donna des lettres patentes qui contiennent
de grands privilèges, dont une partie leur
est encore conservée.
Au carrefour de la rue de Constantine et de
la rue de Maillé, la
maison du Croissant ou
de la Belle Teinturière est un exemple de
maison bourgeoise du XVème siècle. C'est
dans ce quartier que s'installèrent, autour
de 1470, les ouvriers de la soie venus à
Tours à la demande de Louis XI. 
 En
Tourraine, les vers à soie sont
élevés dans des magnaneries
appelées "verreries" ou
"verries". Elles étaient souvent
situées au sein des anciennes
galeries des carrières
désaffectées. Les niches
creusées à même la roche
abritaient les vers à soie En
Tourraine, les vers à soie sont
élevés dans des magnaneries
appelées "verreries" ou
"verries". Elles étaient souvent
situées au sein des anciennes
galeries des carrières
désaffectées. Les niches
creusées à même la roche
abritaient les vers à soie

|
On comptait autrefois
à Tours 700 moulins à dévider, mouliner, &
préparer les soies; 8000
métiers pour
en fabriquer des étoffes; 40000
personnes employées
à dévider la soie, l'apprêter & à la
fabriquer. Tout cela se trouve réduit à 70
moulins, à 1200 Métiers, & à 4000 personnes
seulement qui subsistent de l'ouvrage des
soies.
Cette industrie de
luxe, longtemps rivale de Lyon par la qualité de ses productions, faisait vivre
le tiers de la population active de la ville de Tours au XVIe siècle
 Au
début du XVIIIème siècle, l'activité reprend. L'habilité des dessinateurs de
motifs est reconnue. Grâce à un arrêt du Conseil d'Etat de 1787, leurs modèles
sont protégés pour 15 ans.
Au
début du XVIIIème siècle, l'activité reprend. L'habilité des dessinateurs de
motifs est reconnue. Grâce à un arrêt du Conseil d'Etat de 1787, leurs modèles
sont protégés pour 15 ans.
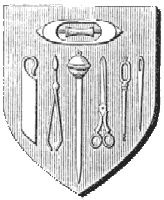 |
De gueules à une épingle
d'argent posée en pal,
surmontée en chef d'une navette plate, accostée à dextre d'un
couteau à couper le velours
et de pinces pour tirer les dents des peignes,
et à senestre d'une paire de ciseaux, d'une passette et d'une
aiguille,
le tout posé en pal et d'argent (D'Hozier).
|
|
L'apprentissage impose à l'apprenti de vivre chez
le maître, celui-ci ayant à la fois un rôle de professeur et
d'éducateur. Un règlement de Colbert fixe en 1667 la durée de
l'apprentissage à cinq ans. L'âge minimum est de treize ou quatorze ans,
mais il faut noter que la Manufacture emploie pour les travaux annexes
beaucoup d'enfants plus jeunes qui n'ont pas le statut d'apprenti. Dans
le contrat, le maître s'engage à "loger
et coucher ledit apprenti, le nourrir de bouche, lui fournir feu et
lumière, lui faire blanchir son gros linge et le perfectionner dans son
art de fabricant en étoffes de soye, sans lui rien cacher de ce qui en
dépend".
Le maître-ouvrier,
lui, peut travailler pour plusieurs fabricants à condition de ne pas
mélanger les fils qui lui ont été fournis. Par ailleurs il a
l'obligation de porter l'ouvrage fini au "Bureau
de la Communauté" pour
être vérifié et qu'il y soit apposé "en
tête et en queue sur une tirelle de deux pouces, les initiales de son
nom, le nom et la qualité de l'étoffe, ainsi que le nombre des portées
dont la chaîne est composée". |
la
Révolte des Canuts, au cri célèbre de "vivre
libre en travaillant ou mourir en combattant",
accompagnée de la non moins célèbre chanson d'Aristide Bruant :
"Mais notre règne arrivera
Quand votre règne finira!
Alors nous tisserons
Le linceul du vieux monde,
Car on entend déjà
La révolte qui gronde!"

Le métier mécanique
a sonné le glas

broché de soie
style restauration
au métier Jacquard.
 
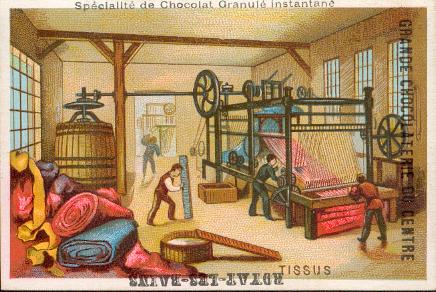
|